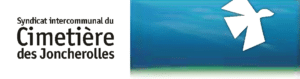Actualité Funéraire
Mars 2023
Principe cardinal de la législation funéraire, la liberté des funérailles est consacrée par loi du
15 novembre 1887 qui confère à toute personne le droit de décider des conditions de ses obsèques. L’art. 3 de cette loi, énonce que : « Tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture. »
En France, deux choix sont possibles pour l’organisation des funérailles : l’inhumation et la crémation.
Cependant, l’évolution de la société et les préoccupations environnementales amènent à réfléchir à de nouveaux modes d’inhumation.
- I) Les nouvelles pratiques funéraires
- L’Aquamation (et sa variante la résomation)
L’Aquamation consiste à procéder à la dissolution par hydrolyse alcaline du corps d’une personne décédée et plongée dans un bain. Il faut baigner le corps du défunt, enveloppé d’un linceul en soie dans une solution alcaline dans un caisson métallique et mettre celui-ci sous pression et le chauffer (93°). Certains protocoles opèrent à 150-180° sous pression pour éviter l’ébullition, on parle de résomation.
Cette méthode se veut davantage écologique, par une consommation en énergie réduite (une crémation nécessite 1000 degrés), et la réduction des gaz à effet de serre (-33%), de mercure ou d’autres métaux nocifs dans l’atmosphère. Cette méthode est considérée plus sure sanitairement que la crémation.
Desmond TUTU, prix Nobel de la paix, a choisi l’aquamation pour ses funérailles.
| D’un point de vue juridique, l’Aquamation est interdite en France en application de l’article R2213-15 du code général des collectivités territoriales qui dispose : « Avant son inhumation ou sa crémation, le corps d’une personne décédée est mis en bière ». En effet, le procédé d’Aquamation n’est pas compatible avec une mise en bière traditionnelle, pour des considérations techniques. De plus, l’Aquamation interroge quant à sa compatibilité avec l’article 16-1-1 du code civil qui dispose : « Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence ».
D’un point de vue éthique, Le Conseil national des opérations funéraires (CNOF) ne s’est pas formellement prononcé en faveur de l’autorisation du processus d’Aquamation funéraire. Cependant, le CNOF conclut en « l’absence d’inconvénient éthique », au cours de la séance du 9 février 2021 retranscrite dans un procès-verbal. En effet, ce mode de sépulture y est mis en parallèle avec la crémation, qui ne pose en elle-même aucun problème éthique pour le CNOF. Il paraît d’ailleurs intéressant de noter que l’aquamation est qualifiée par le CNOF de « crémation par l’eau ». Sur le plan sanitaire, l’Aquamation a pour bénéfice de permettre la neutralisation des bactéries, virus et maladies dont le corps du défunt pourrait être porteur. En outre, l’Aquamation ne nécessite pas une inhumation qui se ferait aux dépens de terrains cultivables et qui provoquerait in fine la pollution des nappes phréatiques par la cadavérise, la putrescine et les résidus médicamenteux des corps. Les eaux usées rejetées sont neutralisées et sont exemptes d’éléments toxiques. Le caractère peu encombrant du matériel nécessaire à l’Aquamation revêt plusieurs avantages d’ordre sanitaire. Dans les territoires enclavés tel que certains archipels français, ce dispositif permettrait de ne pas dépendre des Etats voisins pour la crémation des défunts. A l’échelle de l’ensemble du territoire français, les membres du CNOF soulignent que ce procédé « permettrait de couvrir plus facilement le territoire français avec des unités de proximité ». |
- L’humusation
Il s’agit d’un processus visant à transformer des corps humains par les humuseurs (micro-organismes présents uniquement dans les premiers cm du sol) dans un compost composé de broyats de bois d’élagage, qui transforme, en 12 mois, les dépouilles mortelles en Humus sain et fertile.
- La Promession
Le processus repose sur la désagrégation de la dépouille en fines particules. Le corps du défunt est tout d’abord conservé à une température de -18 °C, pendant plusieurs jours. Le corps est ensuite immergé dans un bain d’azote liquide à -196°C. Enfin, la dépouille est placée sur une table vibrante : les vibrations (mécaniques ou par ultrasons) provoquent la réduction du corps en fines particules.
******
Aspects Juridiques
Ces différents procédés ne sont à ce jour pas compatibles avec le cadre législatif français, qui restreint les modes de funérailles à l’inhumation et la crémation et rend obligatoire l’usage d’un cercueil.
- II) Alternatives écologiques dans les matériaux et équipements funéraires
- Cercueil en carton
Le cercueil en carton présente une alternative à la matière du bois permettant de réduire son usage dans un souci plus respectueux de l’environnement. De plus, le cercueil émet moins de substance toxique lors de sa crémation aucun fluor, aucune émanation de métaux lourds et moins d’oxyde d’azote. Enfin, lorsqu’un cercueil en bois nécessite 10 à 15 ans pour se dégrader dans le sol, le carton nécessite un an.
Début 2009, les cercueils cartons ont enfin été acceptés, sous certaines prescriptions techniques pour l’ensemble des cercueils.
Les dispositifs d’introduction de cercueils pour le crématorium des Joncherolles a été adapté afin de permettre d’accepter les cercueils en carton.
- Cercueils en champignons
Le “Living Cocoon”, est un cercueil 100% naturel agrémenté d’un tapis de mousse, rempli d’insectes et de micro-organismes, qui se chargeront d’accélérer le processus de décomposition et de neutraliser les toxines dans le sol et le corps du défunt. Les corps qui y sont inhumés devraient être entièrement transformés en compost au bout de trois ans.
Ce procédé d’inhumation n’est pas autorisé en France.
- La capsule funéraire
Le défunt est déposé à l’intérieur du cocon, en position fœtale, puis enterré sous terre.
L’arbre se nourrit et s’enracine dans la dépouille du défunt pour devenir un arbre mature au bout de quelques années. La famille peut ensuite retrouver l’arbre et s’y recueillir.
Les capsules funéraires ne sont pas autorisées en France.
- Forêts cinéraires
Une forêt cinéraire est une forêt où les familles peuvent enterrer les cendres d’un défunt, au pied d’un arbre, dans une urne biodégradable (ex : Arbas).
Le régime juridique de ces forêts s’apparente à des sites cinéraires dits « isolés » en ce qu’ils seraient situés hors d’un cimetière et non-contigus à un crématorium.
Le gouvernement indiquait que « Ces projets ne peuvent être mis en œuvre à ce jour en raison d’une incompatibilité des prestations proposées avec le droit funéraire en vigueur, revenant à faire payer aux familles des prestations qui doivent être gratuites […] Cette opération, qui peut par exemple s’effectuer au sein d’un espace naturel forestier, est gratuite mais ne peut donner lieu à la matérialisation d’une sépulture.